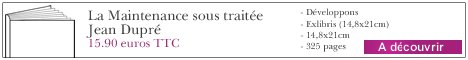On eroticism’s eBook shelves, there is Henry Efbé. To explain his e-book First Penetrations, Henry Efbé begins his analysis in Impertinent Readings:
"The heat crushed the proportions, and cicadas squeal so loud that the temperature still seems to increase with their noises succeeding to hide my tinnitus. My body is becoming increasingly dependent on its age. The night is no longer enough to rest it. Heat annihilates me in summer, but in winter the cold blocks me. With the bright light of the Mediterranean summer, black, translucent, spots, waves and cinders are passing the scope of my gaze. There are blurred areas in my vision range. The permanent sound of a whistle is with me day and night, ceasing only when I fall asleep but immediately present at the recovery of consciousness. I have often sore joints, a hip torture me sometimes and I'm quickly tired, but I’ve yet hard-on. I am sixty-three.
“I’ve published one day an erotic novel in English in which there is nothing autobiographical, it is just a kind of documentary invented in a fictional context on the swapping houses, but I doubt that my description is much more ignominious than reality itself. A way to sublimate, somehow, because men get stiffy even at age 80, while our female companions unleash us the way which justified, perhaps, number of odd couples where the man seems to be the father of the woman he hold incestuously in his arms. I‘m trying to become here the Georges Bataille of myself, by decrypting what the author of First Penetrations would have wanted to mean between the lines. In fact I just started to write it on an unknown word found in crossword puzzles, the word sigisbee (a kind of page or a factotum, in French, dedicated to a lady). From there I imagined a Baroness, transposition of the Gentle Lady of the Middle Ages - in both senses of the term since heroin is a mature, i.e. way not to say aged - in a contemporary era. Already in the first pages of the oppositions of classes abound: the aristocrat Lady does not work, has servants and dominates a man (her sigisbee, her page man) on both ranks social as in the emotional area. The progression of the story will try to restore the inversions. Inversions are also in the political context: the story takes place in a country governed by a dictatorship. You’ll see not any apology of Nazism but rather the parabola of modern capitalist society, which in the name of a fake democracy, is actually little different of a dictatorship. Guinevere Von Strudel, idle, chaste, taking tea with its pairs at regular meetings, is not embodying another real character than I. R., for whom the author worked half of his life, and his membership in the conformist, uptight, American society, where one pretends to be democratic and respectable. Then a new character is introduced in the first chapter: the cleaning lady, as representative of a double opposition. As in conventional morality, this representative of the lower social layers uses her body like animals, while the Baroness does not touch the thing. One was educated so, while the other is prohibited from sex because of a psychological shock, as psychology is reserved for the high sphere of society. We will see later that while the cleaning lady sells herself without any remorse about her self-alienation, the aristocrat is given herself, while seeking to keep control of her domination if not to try to dominate men, as if feminism would be a privilege of the ruling classes.
“Thus the first chapter poses the first milestones, to who would like to discern it, of a plot in a class struggle context, in a way to report that although people say, the class struggle is not over. That was properly astute to spread this idea at the end of the 20th century after the collapse of the Soviet bloc, such that plants managers proclaimed themselves that the classes no longer existed, not aware that this idea had been instilled during their engineer education just because now, engineers would form part of the lower class and that it was more judicious to make them believe. It is true that at the time of Marx and Zola, factory leaders belonged to the elite, which is of course no longer the case since 1990. The leader is the shareholder, and he never set foot at the factory, except for guided tours for which the ground is prepared in a way that he has falsified, idyllic vision of reality.
“In the second chapter the Baroness will be tempted by corruption, and finally plunge as response to her resistance against the attraction she feels for her page. But yield to this attraction would equal deny her fundamental principles which prohibit intimacy with a member of a lower class.
“I had to review my work before to deliver it, or make it review by someone else in order to eradicate the mistakes. But it was unthinkable to entrust this text in the eyes of my family or friends. When you write, the prospect of a reading by relatives censors, even for non-erotic novels. When you create a character, there is something which belongs to relatives you put in his personality. The one who will read will invariably identify with this or that character and his critique will be pointing in this direction. I have therefore imagined to translate it into English to read it again with a different approach. In some ways, A review is made by another myself. »
The novel is available in eBook format on the main distribution sites for less than $1. A PDF version in French is also available, as well as epub format on amazon.
http://www.lulu.com/spotlight/HFB

http://www.amazon.com/First-Penetrations-Henry-Efb%C3%A9-ebook/dp/B00MMM3Z8S/ref=sr_1_1_twi_1_kin?ie=UTF8&qid=1434551407&sr=8-1&keywords=henry+efb%C3%A9